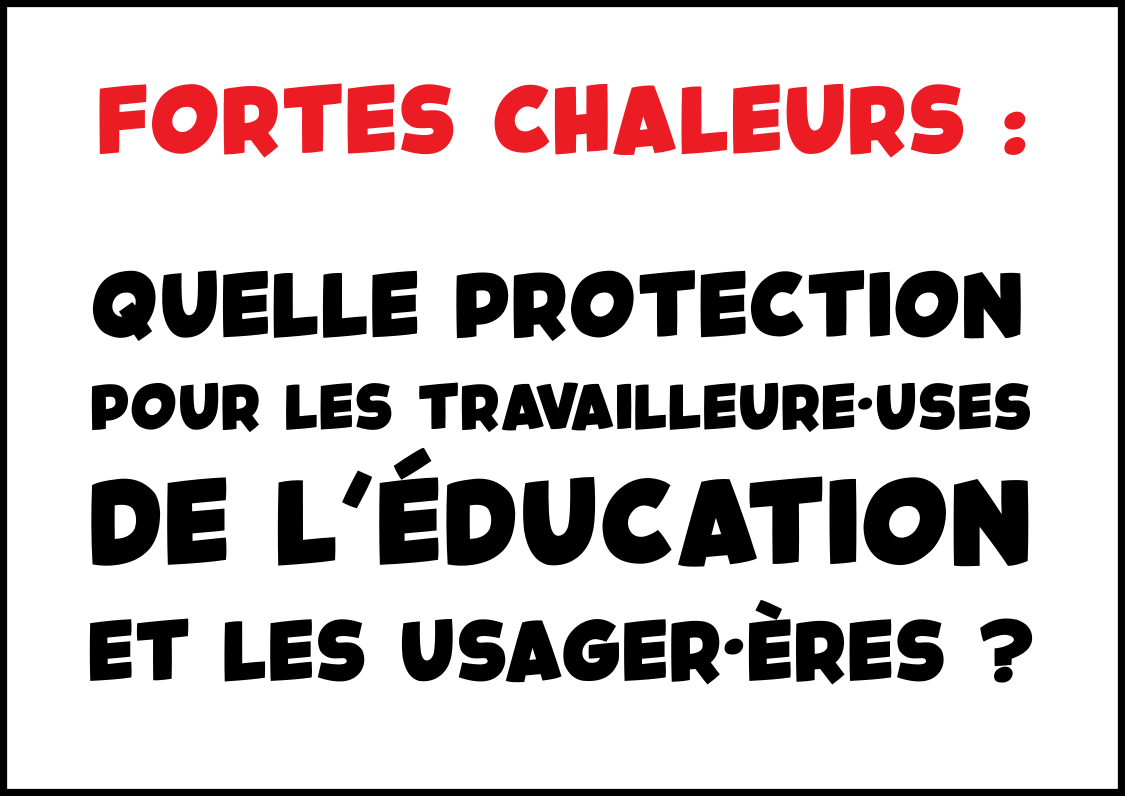Les fortes chaleurs, de plus en plus régulières et intenses, affectent les conditions de travail et d’étude et peuvent mettre en danger la santé des personnels comme des élèves. Alors que le bâti scolaire est largement inadapté pour s’en prémunir, que faire pour nous protéger ?
Au niveau des personnels, faute de dispositions réglementaires spécifiques, nous relevons des dispositions générales du code du travail que vous pouvez retrouver détaillées dans le tuto d’auto-défense syndicale « spécial fortes chaleurs – édition 2025 » de la CNT-SO.
Il est intéressant de se référer notamment aux obligations de chaque employeur, public comme privé sur : l’aération et le renouvellement de l’air dans les locaux, l’aménagement du temps de travail en cas d’alerte météorologique, l’accès à l’eau, la protection des personnels vulnérables…
Malgré des évolutions au 1er juillet 2025, le code du travail a cependant encore trop d’angles morts sur cette question et les mesures de protection qu’il prévoit sont parfois en décalage avec la réalité d’un établissement scolaire (comment adapter les horaires de travail en cas d’alerte canicule par exemple ?).
Le problème principal réside dans l’absence de seuils thermiques clairs, déclencheurs de mesures de protection ! Pourtant des seuils reconnus existent mais relèvent de la simple recommandation ! Il est cependant nécessaire de les connaître car ils sont un point d’appui en cas de démarche collective pour faire valoir nos droits (voir après) :
- L’Institut National de Recherche et de Sécurité considère ainsi que les valeurs de 30 °C pour une activité sédentaire et 28 °C pour un travail nécessitant une activité physique peuvent être utilisées comme repères pour agir en prévention.
- La CNAM recommande de faire évacuer le personnel des bureaux quand les conditions d’hygiène et de sécurité deviennent mauvaises, avec un seuil de température résultante fixé à 34° l’été et 14° l’hiver (recommandation CNAM R.226).
Face à un droit du travail pas suffisamment adapté ni protecteur et une hiérarchie et des collectivités de rattachement peu enclines à mettre en place les mesures structurelles nécessaires, l’action syndicale et collective est déterminante pour notre protection et celle des usager-ères !
Dans les cas plus problématiques, la fermeture partielle ou totale de l’établissement sera la solution qui s’impose. C’est le cas par exemple en cette fin d’année scolaire 2024-2025 avec plusieurs centaines d’établissements fermées en liaison avec les mairies dans le cadre de l’alerte canicule.
LES RESPONSABILITÉS DE LA HIÉRARCHIE
Dans la Fonction publique d’État : « les chefs de service sont chargés, dans la limite de leurs attributions et dans le cadre des délégations qui leur sont consenties, de veiller à la sécurité et à la protection de la santé des agents placés sous leur autorité ». (art 3 décret 82-453)
Dans la Fonction publique territoriale : « Les autorités territoriales sont chargées de veiller à la sécurité et à la protection de la santé des agents placés sous leur autorité » (art 2 décret 85-603).
A ce titre l’évaluation et la prévention des risques relèvent des obligations de notre hiérarchie comme pour un employeur classique. Voir les neuf principes généraux de prévention définis à l’article L4121-2 du code du travail.
A noter que chaque établissement doit établir et réactualiser annuellement le DUERP (document unique d’évaluation des risques professionnels, voir ici) sous supervision des directions/chefs de service et en concertation avec les personnels ou leurs représentant·es (dans le secondaire le pilotage peut se faire par la CHS).
Celui-ci doit aussi être réactualisé :
- Lors « d’aménagements importants modifiants les conditions de santé et de sécurité ou les conditions de travail ».
- « Lorsqu’une information supplémentaire intéressant l’évaluation d’un risque dans une unité de travail est recueillie
La question de l’ambiance thermique doit bien entendu y figurer. Le DUERP doit aussi comporter des mesures de prévention adaptée à l’établissement.
Dans tous les établissements du second degré (au-delà de ceux pour lesquels elle est déjà obligatoire), nous conseillons, dans le cadre du renouvellement annuel des instances, de faire mettre en place une CHS (Commission Hygiène et Sécurité) qui pourra notamment traiter ces questions sur le fonds et la durée (voir ici).
Cette responsabilité peut avoir des conséquences juridiques en cas de préjudice subi par les agent·es ! Il sera utile de le rappeler en cas d’autoritarisme de la hiérarchie locale face à des personnels faisant valoir leurs droits face à une vague de chaleur, notamment les collègues particulièrement vulnérables du fait de l’âge, de la maladie ou de circonstances particulières (grossesse…).
ACCÈS A L’EAU POTABLE
Il doit être mis à disposition de l’eau potable et fraîche (Article R4225-2). En cas d’épisode de chaleur intense, l’eau doit être fournie de manière suffisante, à proximité des postes de travail notamment extérieurs et maintenue au frais toute la journée (Article R4463-4 en vigueur au 01er juillet 2025).
A noter que la mise en place d’une fontaine à eau est obligatoire dans les établissements recevant du public (ERP) de plus de 300 personnes. Au-delà de 600 personnes, une fontaine supplémentaire doit être installée par tranche de 300 personnes. Leur accès est libre et gratuit et doit faire l’objet d’une signalétique visible (par exemple un affichage). Pour plus de détail, voir ici.
LES FICHES RSST ET LE DROIT D’ALERTE
Pour faire bouger notre hiérarchie et les collectivités de rattachement (sur les mesures d’aménagement des locaux) mais aussi baliser un éventuel droit de retrait (voir après), nous conseillons aux personnels de multiplier à titre individuel les alertes via les documents RSST à notre disposition :
– Registre de santé et de sécurité au travail qui doit être mis à disposition des agent·es dans chaque service (un exemplaire doit être aussi accessible au public). Tout avis figurant sur ce registre doit être daté et signé et comporter : l’indication des postes de travail concernés, la nature du danger et sa cause, le nom de la ou des personnes exposées, les mesures prises par le chef de service pour y remédier.
– Registre de signalement d’un danger grave et imminent tenu par le chef de service. Pour les situations les plus graves pouvant entraîner un droit de retrait.
(Si ces registres et fiches ne sont pas disponibles dans les établissements, elles se trouvent sur Internet, consultez notamment les pages F3SCT académiques).
Pour plus de détails, voir notre tuto spécifique ici : https://educ.cnt-so.org/nos-droits-registre-sante-et-securite-au-travail-droit-dalerte-droit-de-retrait/
LE DROIT DE RETRAIT
Comme les salarié·es du secteur privé, les agents publics disposent aussi individuellement du droit de retrait. Les textes réglementaires (voir les sources) sont la transposition des protections prévues dans le code du travail.
CONCRÈTEMENT COMMENT CELA SE PASSE-T-IL ?
Le droit de retrait s’exerce si un·e agent·e a un motif raisonnable de penser que sa situation de travail présente un danger grave et imminent pour sa vie ou pour sa santé ou s’il constate une défectuosité dans les systèmes de protection.
Le danger grave se caractérise par un risque d’accident ou de maladie entraînant la mort ou paraissant devoir entraîner une incapacité permanente ou temporaire prolongée. Le danger imminent se caractérise par le fait qu’il peut se réaliser brutalement dans un délai rapproché. En cas de doute demandez au syndicat !
L’agent·e alerte immédiatement son supérieur hiérarchique et se retire de la situation de danger. Attention, le droit de retrait ne doit pas créer pour autrui une nouvelle situation de danger grave et imminent (collègues et usager·ère·s).
Nous conseillons de faire cette alerte par écrit et de préférence en utilisant les documents mis à disposition des personnels (voir plus haut).
A noter que l’agent·e peut aussi saisir un·e représentant·e au F3SCT (ex-CHSCT) compétent. Un·e représentant·e qui constate une cause de danger grave et imminent peut aussi lancer une alerte sans avoir été saisi par un agent.
A la suite de l’alerte, l’autorité administrative doit procéder immédiatement à une enquête et informer le CHSCT compétent. En cas de divergence sur la réalité du danger ou la façon de le faire cesser, le CHSCT est réuni dans les 24 heures. L’inspecteur du travail est informé de cette réunion et peut y assister. L’administration décide des mesures à prendre après avis du F3SCT. En cas de désaccord entre l’administration et le F3SCT, l’inspecteur du travail est obligatoirement saisi.
L’administration ne peut pas demander à un agent de reprendre son poste si un danger grave et imminent persiste.
Aucune sanction ne peut être prise, aucune retenue de rémunération ne peut être effectuée à l’encontre d’agents qui se sont retirés d’une situation de travail dont ils avaient un motif raisonnable de penser qu’elle présentait un danger grave et imminent pour leur vie ou pour leur santé.
Attention, la notion de « danger grave et imminent » peut être jugée subjective et ne pas être reconnue par l’administration ! Dans ce cas l’employeur ne peut vous imposer le retour au travail qu’avec un ordre écrit et nominatif.
Un recours jugé abusif par l’administration peut éventuellement donner lieu à un retrait de salaire ou une sanction. Nous vous conseillons alors de vous rapprocher du syndicat pour étudier une contestation administrative.
……………………
Sources officielles :
Fonction publique d’État : Décret n°82-453 du 28 mai 1982 relatif à l’hygiène et à la sécurité du travail ainsi qu’à la prévention médicale dans la fonction publique.
Fonction publique territoriale : Décret n°85-603 du 10 juin 1985 relatif à l’hygiène et à la sécurité du travail ainsi qu’à la médecine professionnelle et préventive dans la fonction publique territoriale.
……….
Code du Travail quatrième partie livre Ier à V
Nouveau chapitre du code du travail entre en vigueur concernant la « prévention des risques liés aux épisodes de chaleurs intenses » (articles R4463-1 à R4463-8 du code du travail).
……………………
Sources syndicales
Canicule et travail : droits des salariés et obligations des employeurs en cas de forte chaleur (Tuto de la CNT-SO) : https://cnt-so.org/canicule-et-travail-droits-des-salaries-et-obligations-des-employeurs-en-cas-de-forte-chaleur/
Nos droits – Registre Santé et Sécurité au Travail, droit d’alerte, droit de retrait (Tuto de la CNT-SO Educ) : https://educ.cnt-so.org/nos-droits-registre-sante-et-securite-au-travail-droit-dalerte-droit-de-retrait/